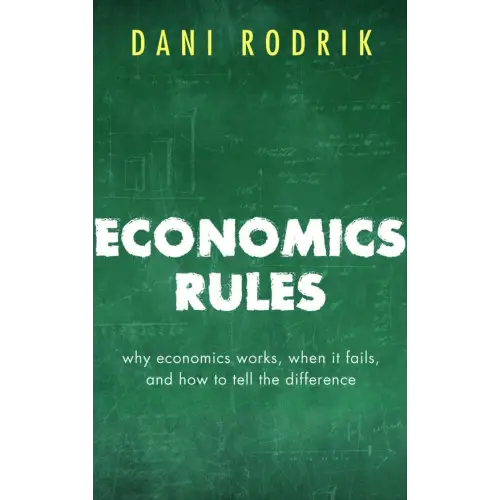Après la crise financière mondiale, l'économie est devenue une cible privilégiée des critiques. Les économistes sont largement critiqués et leur influence est décriée par le grand public. Pourtant, la demande pour leurs services n'a jamais été aussi forte. Pour comprendre ce paradoxe, il est essentiel de comprendre à la fois les forces et les faiblesses de l'économie. Dani Rodrik soutient que la multitude de cadres théoriques – ce que les économistes appellent des « modèles » – qui coexistent constitue sa plus grande force. Les économistes sont formés à envisager divers modèles du monde, potentiellement contradictoires. Cela leur permet, lorsqu'ils font bien leur travail, de comprendre le monde, de formuler des suggestions d'amélioration utiles et d'élargir leurs connaissances au fil du temps. En bref, cela fait de l'économie une « science », certes différente des sciences naturelles comme la physique, mais une science néanmoins. Cependant, le syncrétisme n'est pas un état d'esprit confortable, et les économistes l'abandonnent souvent au profit d'une assurance et d'une arrogance inappropriées, notamment lorsqu'ils abordent des questions politiques. Les économistes sont sensibles aux tendances et se comportent trop souvent comme si leur discipline s'articulait autour de la recherche d'un modèle toujours et partout efficace, plutôt que d'un ensemble de modèles. Leur formation est insuffisante pour naviguer entre différents modèles et déterminer lequel s'applique à quel endroit. L'idéologie et les préférences politiques remplacent souvent l'analyse dans le choix entre les modèles. Ce texte propose à la fois une défense et une critique de l'économie. La manière dont les économistes abordent les phénomènes sociaux présente des avantages significatifs. Mais la nature flexible et contextuelle de l'économie constitue aussi sa faiblesse entre les mains de praticiens incompétents.